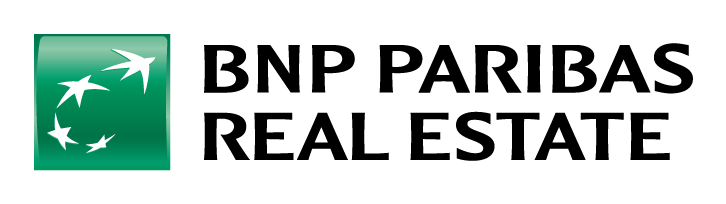La crise sanitaire du coronavirus nous met face aux vulnérabilités et aux failles de notre système. Si de nombreux secteurs ont su prouver leur résilience et leur capacité à s’adapter, notre société entame une période décisive où de véritables choix seront à faire pour construire un avenir basé sur de nouveaux principes de solidarité. Afin de répondre aux enjeux environnementaux et réduire les externalités négatives propres à notre système, il importe de pouvoir remonter des initiatives constructives déjà expérimentées par la population au sein des territoires. Tout comme le secteur de l’immobilier tend à le faire dans ses projets (et ce en lien avec les pouvoirs publics chargés de l’aménagement des territoires), la consultation citoyenne a fait ses preuves afin de répondre aux attentes du quotidien. Une population concernée et impliquée sera plus sensible et réceptive aux perspectives de changement, elle en sera même le moteur et fluidifiera sa mise en œuvre.
Comment consulter les citoyens ?
Nous savons que les défis économiques, écologiques et sociétaux qui nous attendent nécessitent une implication collective et un effort partagé. La planification socio-économique est indissociable des aspirations démocratiques. Cette consultation peut devenir un rendez-vous récurrent afin de renforcer la collaboration et les initiatives citoyennes. C’est aussi l’occasion de mettre en lumière des sujets propres à chaque territoire, avec leurs particularismes, leurs inégalités, mais aussi leurs richesses. Elle est un premier pas vers la valorisation des initiatives locales et certainement un pas vers une décentralisation qui permettrait de mieux répartir les pôles d’activités au sein de toute la France et ainsi de redynamiser certaines zones « désertées ».

Depuis plusieurs jours, les consultations citoyennes sont nombreuses. Citoyens, élus, consommateurs, salariés, syndicats, associations, ONG, système de santé, entreprises… essaient de faire front ensemble pour réfléchir à une façon optimale de surpasser cette crise inédite. C’est en stimulant l’intelligence collective qu’elle pourra se résoudre, au-delà des craintes et inquiétudes. La collaboration avec des spécialistes, des sociologues, des instituts de sondage et l’usage des technologies actuelles (la civ tech) devrait permettre de renouveler ce dialogue. Durant la crise sanitaire, nous avons pu nous rendre compte des services, métiers et produits essentiels au fonctionnement de notre société. Nous avons compris notre interdépendance et la nécessité de recréer du lien malgré nos différences et nos divergences d’opinions.
C’est ce que tente de défendre la plateforme participative « Le Jour d’Après » lancée le 4 avril 2020 par une soixantaine de parlementaires de différentes sensibilités politiques et de différents territoires. La députée LREM du Loiret Caroline Janvier, confirmait le succès de cette plateforme au micro de France 3 Région le 14 avril dernier : « On est contents car c'est un vrai succès, on est à plus de 4000 contributions aujourd'hui. Beaucoup de propositions concernent les modes de consommation. J'ai le sentiment que les gens tirent déjà des leçons de ces quelques semaines de confinement. Ils veulent pérenniser certaines choses, notamment le fait d'avoir une consommation plus locale, plus de circuits courts ». Une tendance largement confirmée par l’enquête IFOP d’avril 2020 pour BNP Paribas Real Estate.
La start-up Fluicity offre également cette possibilité technologique et permet aux personnes concernées de contribuer aux décisions collectives relatives au développement d’un projet dès sa phase de réflexion. Déjà sollicitée dans les projets de promotion immobilière et d’urbanisme, cette plateforme propose également ses services aux agglomérations. L’ambition de sa fondatrice Julie de Pimodan est claire : « On aurait tout intérêt à autant écouter la data et l'opinion des citoyens dans le secteur public. Notre ambition est de proposer un nouveau standard de gouvernance pour la sphère publique européenne », déclarait-elle sur Challenges.fr en mars 2019.
Quelles thématiques préoccupent aujourd’hui les Français ?
Ainsi, le système de santé (importance du personnel soignant, indépendance sanitaire européenne quant à la production de gel, de masques et de médicaments), le monde du travail (redéfinir le home office, le télétravail et les fonctions du siège social), les modes de consommation (valoriser le local, l’agriculture responsable…), la mobilité ou encore l’écologie semblent souvent revenir sur le devant de la scène (source : https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/). Les réseaux sociaux et l’usage des datas sont un véritable catalyseur du débat démocratique et permettent ainsi d’amplifier et de faire converger des solutions.

Pour de nombreux Français, l’injonction à rester chez soi aura soulevé de nombreuses questions sur ce fameux « monde d’après » que nous voulons construire. Certes, les opinions peuvent diverger, c’est le propre de toute démocratie, mais la préservation de l’environnement semble rassembler très largement les citoyens, soucieux d’assurer un développement durable et une économie plus responsable.
La consultation citoyenne au nom éponyme « le monde d’après » lancée par plusieurs associations et ONG le mois dernier a rassemblé 80 000 personnes pour un total de 19 000 propositions à ce jour. La protection de l'environnement représentait 22% des sujets et se plaçait ainsi en première position parmi les autres thématiques évoquées (Source : Futura-sciences). « Végétaliser les villes, reboiser les territoires, sensibiliser la population et notamment les plus jeunes aux problématiques écologiques d'aujourd'hui et de demain, font notamment partie des propositions formulées par les citoyens français qui ont pris part à la consultation ».
De nombreux épidémiologistes l’ont par ailleurs prouvé, la raréfaction de certains milieux naturels, conséquence logique de l’artificialisation des sols dont l’étalement urbain est le principal responsable, favorise l’émergence des épidémies. Qui plus est, le chant des oiseaux, le silence dans les villes, les ciels clairs et les airs plus respirables ont fait du confinement une parenthèse propice à ce qui nous lie à notre environnement, à ce qui n’a pas de valeur marchande, mais continue un patrimoine universel.
L’immobilier comme ambassadeur de la ville inclusive
La transformation d’un territoire ne peut se faire qu’avec la participation de tous les acteurs concernés. Le citoyen doit légitimement être au cœur de la « création » de la ville de demain.
Les villes s’appuient également de plus en plus sur la démocratie participative afin de légitimer leur politique, et ce grâce à des applications capables de partager les propositions de chacun.

Le promoteur immobilier a donc un rôle de premier rang à jouer puisqu’il redessine les lieux et les espaces d’une ville et donc, d’une certaine manière, les interactions et les mouvements des habitants. « Qu’il s’agisse de nouveaux aménagements urbains, de la transformation d’espaces bâtis ou du développement de nouvelles urbanités, il est primordial d’associer l’utilisateur final à la préfiguration du projet afin d’assurer une cohérence entre la conception des espaces et les usages qu’ils sauront accueillir », affirme Séverine Chapus, Directrice Générale Adjointe des grands projets mixtes de BNP Paribas Real Estate.
« Intégrer les habitants dans des actions socioculturelles ou événementielles temporaires lors de la réalisation de nos projets, en nous appuyant sur les écosystèmes locaux et le tissu associatif du territoire, fait partie des démarches que nous mettons en œuvre […]. À la fois vectrice d’intégration et de dynamisme des territoires, la participation citoyenne est clé pour faire émerger de véritables lieux de vie qui répondent durablement aux attentes et besoins des utilisateurs et profondément renouveler l’expérience immobilière et urbaine ».
Suivez l'actualité du secteur

BNP Paribas Real Estate et Willow : l’IA au service d’une nouvelle génération de bâtiments
En s’associant à Willow et à son assistant intelligent Willow Copilot, BNP Paribas Real Estate franchit une nouvelle étape dans la transformation digitale de ses bâtiments.
Cette collaboration stratégique vise à renforcer la capacité des gestionnaires à exploiter pleinement les données du bâtiment, afin d’accélérer l’émergence d’immeubles plus performants, plus durables et plus attentifs aux besoins des occupants.
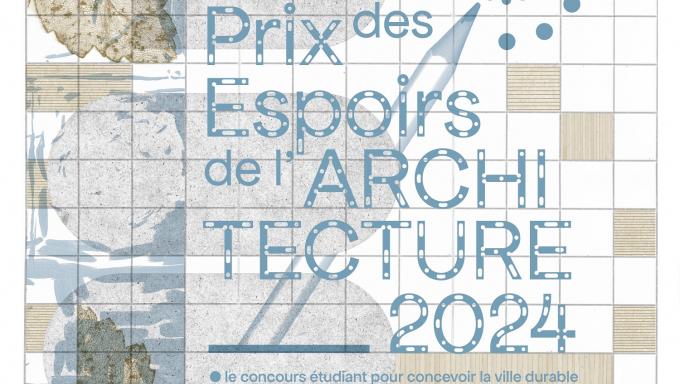
Prix des Espoirs de l’Architecture de BNP Paribas Real Estate : Qui sont les lauréats de la 17ème édition ?
Chaque année, BNP Paribas Real Estate propose le concours du Prix des Espoirs de l’Architecture aux étudiants en 4ème ou 5ème année d’architecture ou en bi-cursus architecture / ingénieur. L’objectif est de les sensibiliser aux problématiques actuelles de l’architecture, notamment en termes de développement durable.

La réversibilité immobilière est-elle la clé de la résilience urbaine ?
Les besoins des occupants évoluent de plus en plus rapidement, un rythme ardu à soutenir pour l’écosystème immobilier où les temps d’études, d’obtentions administratives et de construction sont difficilement compressibles. La solution ne serait-elle pas de bâtir autrement ? Comme nous, un immeuble peut avoir plusieurs vies, pourquoi le cantonner à un seul usage ? La réversibilité immobilière, c’est-à-dire la capacité pour un bâtiment d’anticiper et de s’adapter aux usages futurs, est-elle la clé ?

85 rue du Dessous des Berges à Paris, une reconversion immobilière vertueuse
L’immeuble de bureaux situé au 85 rue du Dessous des Berges à Paris va devenir un établissement d’enseignement supérieur. Poursuivant sa stratégie de valorisation patrimoniale, la filiale Investment Management de BNP Paribas Real Estate (REIM) transforme un des actifs phares de sa SCPI France Investipierre.