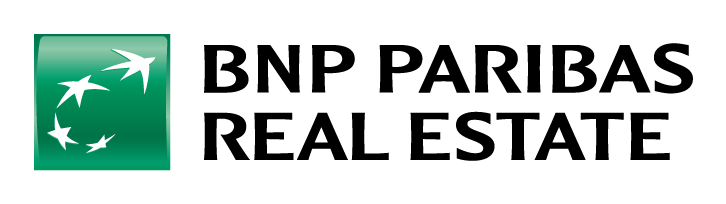Les villes du monde entier représentent des foyers de cultures et d'innovations. Aucunes villes ne sont similaires, mais chacune apporte des idées sur la façon de vivre et d'interagir les uns avec les autres. Avec de nombreux acteurs impliqués dans de nouveaux processus de développements et un flux constant de programmes et d'initiatives, la ville est en constante évolution. Alors, comment construire une ville pour ses habitants ? Est-il possible de proposer des infrastructures et des services adaptés à tous ? Afin d'obtenir des réponses, nous nous sommes entretenus avec Kate Jeffery, professeure de Neuroscience Comportementale à University College London et Victoria Lee, spécialiste en stratégie d’aménagement urbain.
>>> Découvrez l'étude Smart Métropole « Paris Ville-Monde » <<<
L’humain au cœur de la conception des villes
« Sur les grands projets, il y a des demandes concurrentes, que ce soit de la part de l'investisseur, du développeur ou de l'autorité locale », déclare Victoria Lee. « En plus de cela, il y a des exigences politiques nationales et locales, ainsi que des contraintes physiques en termes de conception. Ajoutez également les facteurs socio-économiques qui composent un projet. Les villes peuvent-elles être conçues pour satisfaire tout le monde ? Je pense que c’est possible mais il faut penser à l’équilibre. Pas seulement entre les personnes ou l'argent, mais aussi entre design, gouvernance et aménagement ».
Alors que différents projets de développement des villes sont soumis à des processus décisionnels et à l’implication d’un certain nombre de parties, Kate Jeffery tient quant à elle à souligner un critère essentiel; comment le cerveau humain fonctionne dans les différents espaces. « Je pense que comprendre comment le cerveau organise l'information spatiale devrait être intégré à l'architecture. En effet, les outils que nous utilisons en science pourraient être très utiles afin de découvrir comment les gens utilisent l'espace, comment ils s'y sentent et s'il répond à leurs attentes. Autant d’éléments importants à prendre en compte pour un bâtiment », justifie-t-elle.
Nos villes peuvent-elles être davantage axées sur les données ?
Le manque d'analyses effectuées sur la façon dont les habitants se sentent et interagissent dans les différents espaces constitue un problème pour les acteurs impliqués dans la conception et la planification de la ville. Si la tâche n’est pas simple, Victoria Lee souligne que « nous devons rassembler de plus grandes quantités de données sur nos villes, et en particulier des données relatives aux sentiments. Il ne s’agit pas seulement de responsabiliser le promoteur foncier; vous responsabilisez également les populations locales. L'engagement donne une vraie voix à la population et cela se fait en posant les bonnes questions ».
Du point de vue des neurosciences, Kate Jeffery tient à mentionner que les villes rassemblent un large éventail de personnes et que les besoins de tous ne seront donc pas les mêmes. Comme elle l'explique, « je pense que la clé pour vraiment comprendre les habitants et leur relation avec la ville est de collecter plus de données. Cela se ferait en examinant les villes et en évaluant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je ne pense pas qu’il existe une réponse universelle à cette question et il est important de reconnaître qu’il existe de nombreuses variations individuelles. Certaines personnes aiment les grands espaces, d'autres s'y sentent mal à l'aise et préfèrent les espaces cosy. Certaines personnes aiment marcher, d'autres détestent ». Il y a clairement de nombreuses variables impliquées dans la collecte de données, mais comme les villes sont des lieux qui dépendent de l'activité humaine, il semble naturel d’intégrer le comportement et les sentiments humains à une plus grande échelle.

Construire des espaces vraiment inclusifs
Le sentiment joue donc un rôle déterminant dans l’appréhension d’un espace et est à l’origine de l’étiquetage de certains quartiers d’une ville comme « dangereux ». Kate Jeffery clarifie ce point : « Le cerveau établit un pan de la ville et détermine ensuite les zones sont dangereuses, ou bien encore celles pour aller chercher de la nourriture. Elles sont toutes établies en fonction de l'emplacement physique et des expériences vécues. Nous traitons constamment la mise en page, formons des souvenirs et apprenons, afin de construire une représentation interne très riche. Je suis convaincue que si vous n’êtes pas en mesure de former une bonne représentation mentale de la configuration d’une ville, vous ne vous y sentez pas totalement à l’aise ».
Si la conception d'une ville est essentielle pour les bien-être des habitants, elle peut également être source d’isolement, notamment à travers l’accès payant à certains espaces. Comme le confirme Victoria Lee, « je pense que certaines villes sont en train de s'orienter vers une conception excessive et une sur-gouvernance, ce qui signifie que diverses communautés de différents milieux socio-économiques peuvent se sentir conditionnées par ces espaces ».
L'effet Covid-19
Lorsqu'il s'agit de parler de la pandémie de la Covid-19, Kate Jeffery et Victoria Lee proposent des visions différentes sur la manière dont les villes vont s'adapter à la crise sanitaire. Pour Victoria Lee, il s’agit d’ouvrir nos villes à un nouveau rapport au temps. Comme elle l'explique, « la Covid-19 ajoutera du temps à l'équation du développement urbain. Les villes contraintes dans l'espace apprendront à utiliser le temps plus efficacement. Cela signifie des villes de 24 heures, avec certaines activités réalisées à des moments très différents de la journée. Si vous pouvez faire vos courses au supermarché à 23h ou 12h, vous vous distanciez socialement des gens qui font leurs courses à 10h. L'économie peut continuer parce que vous êtes en mesure de fournir des emplois aux gens la nuit et le jour. L'avenir du travail devient différent. C'est un élément de conception qui, je pense, deviendra beaucoup plus répandu dans la conception des villes ».

Pour Kate Jeffery, l'accent sera davantage mis sur les risques et les limites que les gens s'imposent. « Les gens pèsent toutes sortes de facteurs. Sont-ils à l'aise d'aller à la plage ou bien à un match de rugby alors que certaines personnes préfèrent rester à la maison ? Ils sont frustrés si le choix leur est enlevé », explique-t-elle. « Nous voulons vivre dans un environnement où nous pouvons faire ce que nous voulons en étant conscients du risque de transmission. Je pense que les ingénieurs auront un rôle important à jouer pour garantir un monde sûr, mais nous devons reconnaître que nous sommes des animaux sociaux, et nous devons donc en tenir compte d’une manière ou d’une autre ».
LIRE NOS AUTRES ACTUALITÉS

BNP Paribas Real Estate et Willow : l’IA au service d’une nouvelle génération de bâtiments
En s’associant à Willow et à son assistant intelligent Willow Copilot, BNP Paribas Real Estate franchit une nouvelle étape dans la transformation digitale de ses bâtiments.
Cette collaboration stratégique vise à renforcer la capacité des gestionnaires à exploiter pleinement les données du bâtiment, afin d’accélérer l’émergence d’immeubles plus performants, plus durables et plus attentifs aux besoins des occupants.
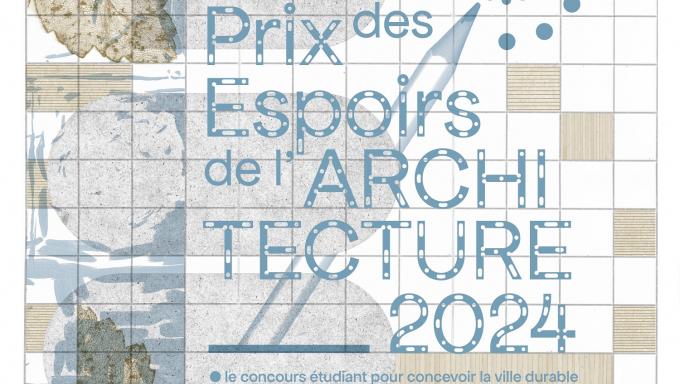
Prix des Espoirs de l’Architecture de BNP Paribas Real Estate : Qui sont les lauréats de la 17ème édition ?
Chaque année, BNP Paribas Real Estate propose le concours du Prix des Espoirs de l’Architecture aux étudiants en 4ème ou 5ème année d’architecture ou en bi-cursus architecture / ingénieur. L’objectif est de les sensibiliser aux problématiques actuelles de l’architecture, notamment en termes de développement durable.

La réversibilité immobilière est-elle la clé de la résilience urbaine ?
Les besoins des occupants évoluent de plus en plus rapidement, un rythme ardu à soutenir pour l’écosystème immobilier où les temps d’études, d’obtentions administratives et de construction sont difficilement compressibles. La solution ne serait-elle pas de bâtir autrement ? Comme nous, un immeuble peut avoir plusieurs vies, pourquoi le cantonner à un seul usage ? La réversibilité immobilière, c’est-à-dire la capacité pour un bâtiment d’anticiper et de s’adapter aux usages futurs, est-elle la clé ?

85 rue du Dessous des Berges à Paris, une reconversion immobilière vertueuse
L’immeuble de bureaux situé au 85 rue du Dessous des Berges à Paris va devenir un établissement d’enseignement supérieur. Poursuivant sa stratégie de valorisation patrimoniale, la filiale Investment Management de BNP Paribas Real Estate (REIM) transforme un des actifs phares de sa SCPI France Investipierre.