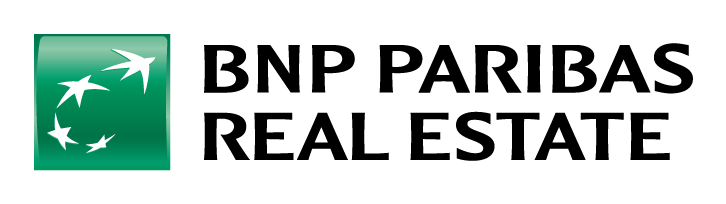Après plusieurs semaines de télétravail, la perspective d’un retour au bureau progressif se profile pour des millions de Français à partir du 11 mai prochain. La date est posée, et les contours de ce déconfinement semblent se dessiner. Ecoles, entreprises, transports… tous s’organisent même si aucun n’envisage un retour à la normale avant plusieurs mois. La vie reprendra son cours par étape. Outre les consignes relevées par le Ministère du Travail dans le plan de déconfinement pour les entreprises du secteur privé, les entreprises s’organisent elles aussi pour assurer la sécurité de leurs collaborateurs. Des mesures qui semblent trouver un écho positif auprès des salariés qui avouent à 80% avoir confiance en leur employeur que ce soit pour l’articulation du retour progressif au travail, mais aussi sur la mise à disposition, au sein des locaux, de mesures et outils jugés indispensables pour la sécurité des salariés.
Quelles sont les motivations des Français à retourner sur leur lieu de travail ? Souhaitent-ils prolonger les gestes barrières en restant en télétravail ? Que pensent-ils des décisions prises par leurs entreprises ? Quels critères jugent-ils indispensables ?... Découvrez la seconde vague du baromètre réalisé par BNP Paribas Real Estate en partenariat avec Ifop sur les conditions de vie et de travail des Français à l’épreuve du confinement (1 501 interviewés). Une enquête menée en plusieurs vagues tout au long de cet épisode inédit, pour prendre le pouls de la situation et tirer demain des analyses éclairées sur la façon dont les entreprises doivent s’adapter.
Le souhait -mitigé- de regagner son lieu de travail habituel après le 11 mai
Si la perspective du déconfinement approche à grands pas, le Premier ministre français Edouard Philippe tout comme les pouvoirs publics et entreprises appellent néanmoins à une prolongation du télétravail au cours des 3 prochaines semaines, donc bien au-delà du 11 mai. Un appel entendu par la grande majorité des Français qui ne sont que 38% à confier vouloir retourner exercer leur activité professionnelle sur leur lieu de travail comme avant le confinement contre 62% qui souhaiteraient prolonger l’expérience du télétravail de façon élargie (32%) ou complète (30%). Si le besoin de lien social se fait ressentir (31%), les motivations premières du retour au bureau concernent avant tout une reprise totale de l’activité (38%) et le besoin de disposer d’outils uniquement accessibles depuis les locaux de l’entreprise (32%).
Les collaborateurs qui souhaiteraient privilégier l’option télétravail émettent des craintes liées au coronavirus (61% mais jusqu’à 73% pour les actifs basés en Ile-de-France et les personnes travaillant en boutique) et relèvent aussi l’appétence nouvelle ou confirmée du travail à la maison (37%), ainsi que le gain de temps généré dû à l’absence de temps de transports (26%).

La responsabilité perçue de différents acteurs pour protéger les salariés du coronavirus lors de leur reprise du travail
Les Français avouent accorder une solide confiance à l’égard de leur employeur pour assurer un retour au travail en toute sécurité.
La responsabilité de protéger les salariés du coronavirus lors de la reprise du travail au sein de l’entreprise repose, aux yeux des Français, tout autant sur les employeurs (94% estiment qu’il en va de leur responsabilité), les pouvoirs publics (87%) mais également les salariés eux-mêmes (90%). Toutefois, si les personnes interrogées font montre d’une solide confiance à l’égard de leurs collègues (80%) ou de leur employeur pour ce faire (78%), il n’en pas de même s’agissant des pouvoirs publics puisque seul un peu plus d’un actif sur deux déclare leur faire confiance (53%).
Il est également intéressant d’observer que les CSP+, les salariés du privé mais également ceux travaillant dans des entreprises de 1 à 49 salariés sont encore plus confiants à l’égard de leur employeur que les autres. Plus précisément, on observe que les salariés font tout autant confiance à leur entreprise pour articuler le retour progressif à une situation normale (80%) que pour garantir sur place les moyens nécessaires à la protection des salariés (79%).
Les principaux critères jugés indispensables par les Français pour une reprise du travail en toute sécurité
Nous retrouvons à :
- 82% la présence de gel hydro-alcoolique dans tous les bureaux et espaces de réunions,
- 81% le nettoyage régulier et adapté des locaux de l’entreprise,
- 78% le respect strict de la distanciation sociale d’un mètre entre chaque salarié,
- 63% l’obligation pour tous les salariés de porter un masque.
Autant d’aspects qui reposent principalement sur les épaules des employeurs. Devant les mesures plus contraignantes pour les actifs et qui constituent, probablement encore à leurs yeux, des privations de libertés :
- 53% la limitation des déplacements professionnels,
- 50% l’interdiction des réunions physiques,
- 43% les sanctions pour les salariés qui ne respectent pas les règles
Jusqu’à une certaine incohérence à partir du moment où fermeture des lieux de vie communs (cafétérias, RIE…) et l’instauration d’horaires décalés sont les mesures jugées les moins indispensables (respectivement 41% et 36%) alors même qu’elles sont celles qui permettront la mise en œuvre de la distanciation sociale.
Pour autant, à la question de savoir s’il vaut mieux organiser un retour très progressif des salariés dans les locaux ou prévoir un retour rapide pour permettre une reprise de l’activité, trois quarts d’entre eux optent pour la première option (76%) ; confiance en son employeur donc, mais aussi conscience de la tâche à accomplir.
Le télétravail, grand gagnant du confinement ?
Les actifs ne questionnent quasiment pas la pertinence du développement du télétravail : plus de huit sur dix d’entre eux jugent souhaitable que la pratique se développe massivement (83%) et trois quarts d’entre eux estiment cette hypothèse vraisemblable (75%).
Si le caractère souhaitable du développement massif du télétravail fait l’objet d’un large consensus (les cadres supérieurs et professions intellectuelles, davantage concernés, sont les plus enthousiastes), l’opinion est plus partagée quant à sa faisabilité. Les femmes, les actifs plus âgés et les ouvriers sont plus sceptiques.
Les Français semblent cependant relativiser les conséquences sur le long terme du recours massif à cette pratique.
Ils sont en effet relativement partagés quant à la crédibilité de l’ensemble des répercussions à savoir que les salariés aillent vivre où ils le souhaitent (65%), que chacun soit libre d’adapter ses horaires de travail à ses contraintes personnelles (59%) et que chacun travaille d’où bon lui semble (56%). La corrélation entre le caractère souhaitable et vraisemblable se vérifie systématiquement et ceux qui jugent les différentes conséquences crédibles sont aussi ceux qui les souhaitent les plus vivement.
Un point de vigilance toutefois : l’assimilation de la culture de l’entreprise par les salariés, dont les actifs doutent qu’elle puisse se faire en télétravail (59% estiment que les salariés en télétravail ne seront pas sensibles à la culture de l’entreprise) ce qui ne serait pas souhaitable pour 71% d’entre eux.

Le retour au bureau semble ainsi se profiler d’une façon inédite et renouvelée. Ces quelques mois ont permis aux Français d’expérimenter sur une longue période de nouveaux modes et habitudes de travail qu’il conviendra d’analyser et de décrypter en profondeur dans les prochains mois. Ces organisations et les investissements réalisés par les entreprises (outils, sanitaires…) permettent toutefois de démontrer que les organisations n’ont en rien perdu de leur efficacité au travers du déploiement du télétravail. S’il est encore difficile de prédire sa généralisation et sa poursuite à long terme, gage que cette période inédite va profondément impacter notre vision du travail, de l’entreprise, et du futur du siège social.
[METHODOLOGIE]
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans de 1 501 personnes. Celle-ci a été conduite par l’institut d’études et de sondage Ifop. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’interviewé) après stratification par région et par catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 28 au 29 avril 2020.
Suivez l'actualité du secteur

BNP Paribas Real Estate et Willow : l’IA au service d’une nouvelle génération de bâtiments
En s’associant à Willow et à son assistant intelligent Willow Copilot, BNP Paribas Real Estate franchit une nouvelle étape dans la transformation digitale de ses bâtiments.
Cette collaboration stratégique vise à renforcer la capacité des gestionnaires à exploiter pleinement les données du bâtiment, afin d’accélérer l’émergence d’immeubles plus performants, plus durables et plus attentifs aux besoins des occupants.
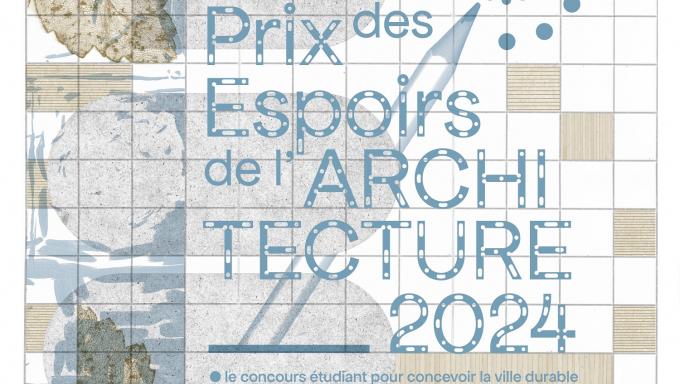
Prix des Espoirs de l’Architecture de BNP Paribas Real Estate : Qui sont les lauréats de la 17ème édition ?
Chaque année, BNP Paribas Real Estate propose le concours du Prix des Espoirs de l’Architecture aux étudiants en 4ème ou 5ème année d’architecture ou en bi-cursus architecture / ingénieur. L’objectif est de les sensibiliser aux problématiques actuelles de l’architecture, notamment en termes de développement durable.

La réversibilité immobilière est-elle la clé de la résilience urbaine ?
Les besoins des occupants évoluent de plus en plus rapidement, un rythme ardu à soutenir pour l’écosystème immobilier où les temps d’études, d’obtentions administratives et de construction sont difficilement compressibles. La solution ne serait-elle pas de bâtir autrement ? Comme nous, un immeuble peut avoir plusieurs vies, pourquoi le cantonner à un seul usage ? La réversibilité immobilière, c’est-à-dire la capacité pour un bâtiment d’anticiper et de s’adapter aux usages futurs, est-elle la clé ?

85 rue du Dessous des Berges à Paris, une reconversion immobilière vertueuse
L’immeuble de bureaux situé au 85 rue du Dessous des Berges à Paris va devenir un établissement d’enseignement supérieur. Poursuivant sa stratégie de valorisation patrimoniale, la filiale Investment Management de BNP Paribas Real Estate (REIM) transforme un des actifs phares de sa SCPI France Investipierre.