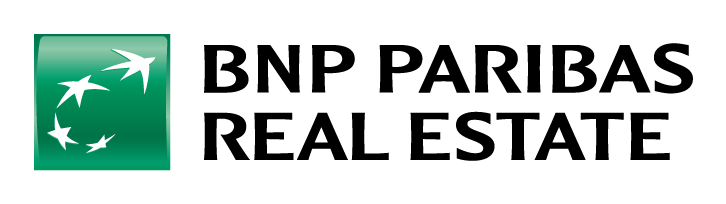Ouragans, hausse du niveau des océans, feux de forêt à l’orée des villes : d'ici trente ans, les climatologues prévoient non seulement un réchauffement global des températures sur la planète, mais également une augmentation des événements climatiques extrêmes. Sans compter les catastrophes anthropiques, non directement liées au climat.
Comment repenser nos modèles urbains face à de tels phénomènes ? Résilience urbaine, planification et évolution des comportements énergétiques semblent être les maîtres-mots. Explications.
La ville : un écosystème particulièrement vulnérable
Juin 2019 a été le mois le plus chaud que la Terre n’ait jamais connu depuis que les relevés météo existent. Tandis que le mercure dépassait 40°C dans de nombreuses villes européennes, il flirtait dangereusement avec les 50°C dans des mégalopoles d’Inde et du Pakistan. Juin 2019 est aussi le 414e mois consécutif avec des températures plus élevées que la moyenne, selon l’ONU.
Si les projections chiffrées des climatologues ne cessent de faire débat quant au nombre exact de degrés Celsius supplémentaires auquel il faut s’attendre – ou de centimètres en plus du niveau de la mer – une chose met tout le monde d’accord : les phénomènes liés au réchauffement climatique sont voués à se multiplier en ville dans les trente ans à venir. Nous avons encore tous en tête les images de la catastrophe de la Nouvelle Orléans ou, plus récemment, des incendies ravageurs aux portes d’Athènes.
La question est éminemment politique, mais les urbanistes et les architectes ont aussi un rôle crucial à jouer pour réduire les risques et anticiper les changements, à l’échelle de la ville et du bâtiment.
Objectif : trouver le bon équilibre pour s’adapter au climat et garantir la sécurité et le confort thermique des habitants.

- 68 % de la population mondiale vivra en ville en 2050 (contre 55 % aujourd’hui)
- À l’horizon de 2100, 2 Européens sur 3 seront affectés par des catastrophes climatiques (contre 5 % sur la période 1981-2010)
- 65 % des agglomérations de plus de 5 millions d’habitants sont situées sur un littoral. De graves risques d’inondations, de submersion et de déplacement massif des populations sont à prévoir.
Lutter contre les îlots de chaleur urbains
Si l’on prend l’exemple de Paris, l’îlot de chaleur urbain (ou ICU) formé sur la capitale et sa petite couronne connaît en moyenne des températures 2 à 3°C supérieures sur l’année par rapport aux zones rurales alentour, comme les forêts de Meudon ou de Fontainebleau[1]. Reste qu’au sein d’une même ville, la température peut aussi varier significativement d’un quartier à l’autre, voire d’un bloc de bâtiments à l’autre.
Ce phénomène d’îlots de chaleur urbains est amené à s’intensifier dans les prochaines décennies. Selon les experts du Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM), la densité du bâti, la morphologie et l’architecture des bâtiments ont aussi une influence directe sur les ICU. L’impact dépendra aussi des pratiques énergétiques des entreprises, des industries et des habitants pour chauffer, ventiler ou climatiser les bâtiments.
« Les pratiques des habitants et usagers dans les bâtiments influent sur les consommations d’énergie, mais aussi le climat urbain et l’îlot de chaleur, pouvant accroître celui-ci de 1 à 2°C. »
Optimiser les scénarios de végétalisation des façades en diversifiant les espèces végétales, et en redistribuant les espaces verts et parcs urbains
Prendre en compte les couloirs de ventilation d’air propre existants dans les PLU et encourager les corridors écologiques (renaturation des cours d’eau urbains, etc.)
Réduire les rejets de chaleur anthropique (climatisation, etc.)
Choisir les matériaux selon leur albédo, c’est-à-dire leur pouvoir réfléchissant
Initier une démarche de résilience climatique… et urbaine
S’adapter et s’habituer à des pics de température de plus en plus fréquents et intenses dans les villes, avoir les moyens, en tant qu’individu, communauté ou entreprise, de se relever rapidement à la suite de dégâts liés à une crue ou à une pandémie. Cette capacité à faire front collectivement et individuellement et à s’ajuster sans cesse à la fureur du climat – et à ses nombreuses conséquences collatérales – sera clé dans les décennies à venir.
« Le concept de résilience est à la fois une aspiration et une démarche opérationnelle […] La résilience à l’échelle d’une ville assimile une zone urbaine à un système dynamique et complexe qui doit s’adapter en permanence aux divers défis d’une manière holistique et intégrée. »
Compte rendu de la conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable – Quito, octobre 2016
L’ONU Habitat parle même de « résilience urbaine ». Plusieurs grandes métropoles dans le monde ont déjà déployé des stratégies de résilience, qui intègrent non seulement la question climatique et environnementale, mais plus largement les problématiques socio-politiques et économiques. Parmi elles, la ville de Medellín, en Colombie, qui fait figure de cas d’école au niveau mondial. À la faveur d’une ambitieuse politique d’urbanisme social, cette mégalopole de 2,5 millions d’habitants est passée en quelques années du statut de ville la plus dangereuse à celle de ville la plus innovante du monde. Grâce à cette démarche holistique et inclusive de planification urbaine, il y a fort à parier que Medellín a aussi une longueur d’avance pour affronter la hausse progressive des températures qui l’attend ces trente prochaines années.


BNP Paribas Real Estate et Willow : l’IA au service d’une nouvelle génération de bâtiments
En s’associant à Willow et à son assistant intelligent Willow Copilot, BNP Paribas Real Estate franchit une nouvelle étape dans la transformation digitale de ses bâtiments.
Cette collaboration stratégique vise à renforcer la capacité des gestionnaires à exploiter pleinement les données du bâtiment, afin d’accélérer l’émergence d’immeubles plus performants, plus durables et plus attentifs aux besoins des occupants.
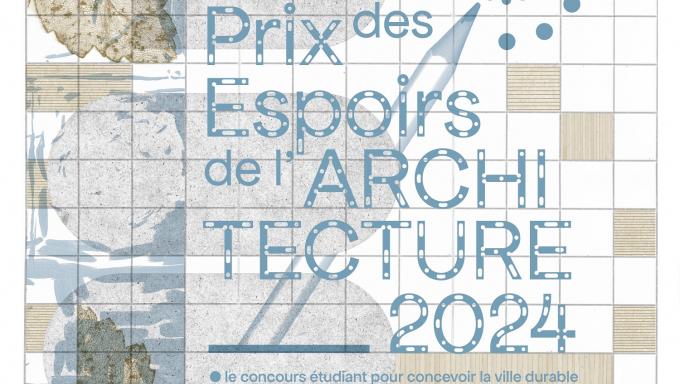
Prix des Espoirs de l’Architecture de BNP Paribas Real Estate : Qui sont les lauréats de la 17ème édition ?
Chaque année, BNP Paribas Real Estate propose le concours du Prix des Espoirs de l’Architecture aux étudiants en 4ème ou 5ème année d’architecture ou en bi-cursus architecture / ingénieur. L’objectif est de les sensibiliser aux problématiques actuelles de l’architecture, notamment en termes de développement durable.

La réversibilité immobilière est-elle la clé de la résilience urbaine ?
Les besoins des occupants évoluent de plus en plus rapidement, un rythme ardu à soutenir pour l’écosystème immobilier où les temps d’études, d’obtentions administratives et de construction sont difficilement compressibles. La solution ne serait-elle pas de bâtir autrement ? Comme nous, un immeuble peut avoir plusieurs vies, pourquoi le cantonner à un seul usage ? La réversibilité immobilière, c’est-à-dire la capacité pour un bâtiment d’anticiper et de s’adapter aux usages futurs, est-elle la clé ?

85 rue du Dessous des Berges à Paris, une reconversion immobilière vertueuse
L’immeuble de bureaux situé au 85 rue du Dessous des Berges à Paris va devenir un établissement d’enseignement supérieur. Poursuivant sa stratégie de valorisation patrimoniale, la filiale Investment Management de BNP Paribas Real Estate (REIM) transforme un des actifs phares de sa SCPI France Investipierre.