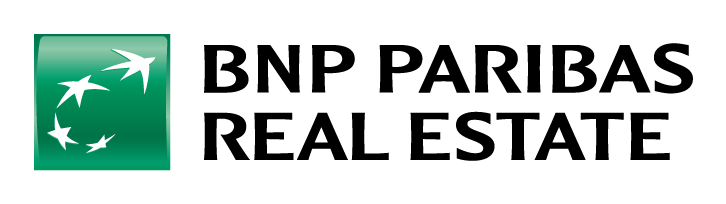Les villes accueillent aujourd’hui plus de 54 % de la population mondiale et ce chiffre devrait atteindre près de 68 % en 2050 selon l’ONU[1]. Deux humains sur trois habiteront alors dans des villes ou des centres urbains. Une urbanisation galopante qui demande à être davantage encadrée et maîtrisée puisqu’elle s’accompagne de nouveaux risques : changements climatiques, épidémies, crises sanitaires et géopolitiques…. Comment les villes peuvent-elles alors intégrer ces différents paramètres pour gagner en résilience ? Entretien avec Olivier Bokobza, Deputy Chief Executive Officer of BNP Paribas Real Estate in charge of Property Development et Séverine Chapus, Deputy Chief Executive Officer of Property Development (Commercial & Residential) in charge of Development at BNP Paribas Real Estate.
Quelles sont les caractéristiques d’une ville résiliente ?
Severine Chapus
Si la résilience revient sur le devant de la scène avec le Covid-19, on peut se rappeler que cette notion avait également pris une place importante dans l’analyse des conséquences du tsunami de 2004 en Asie. Plusieurs études avaient alors démontré que plus la cohésion sociale était forte, et ce à divers échelons (voisinage, quartier, métropole) plus la ville revenait facilement à un état « normal » après un choc. En effet plus un tissu social est étroitement maillé, plus il retrouve facilement sa forme originelle et son état de fonctionnement.
Olivier Bokobza
La gouvernance est pour moi le pivot de la réussite d’une ville résiliente de demain. Elle ne peut pas se concrétiser sans une ligne directrice claire et structurée. La volonté politique des élus qui dessinent la ville est donc primordiale.
Par ailleurs, la mixité représente ainsi une nécessité pour l’avenir de l’urbanisme. Source d’économie, mais aussi d’animation, elle participe à une vraie consommation locale et influe sur notre chaîne de valeur immobilière. Quand nous réalisons des opérations de bureaux nous pouvons développer des opérations de logements, quand nous faisons des opérations de logements nous pouvons développer des opérations de logements sociaux intermédiaires pour permettre une mixité sociale à l’échelle d’un quartier ou d’une ville et contribuer à la création d’un environnement partagé et solidaire.

En quoi l’épidémie de Covid-19 a-t-elle impacté et impactera-t-elle les infrastructures des villes européennes ?
Séverine Chapus
Cette épidémie ouvre un nouveau rapport au temps et à l’espace. Les géographe et sociologue Luc Gwiazdzinski et Benjamin Pradel, l’ont formulé très justement : ces dernières décennies, nous avons aménagé l’espace et les infrastructures pour gagner du temps. Or l’une des questions qui nous est aujourd’hui posée avec la crise sanitaire est comment aménager le temps, à savoir nos rythmes de vie et de développement urbain, pour gagner de l’espace. Lors du déconfinement, l’urbanisme tactique a montré ses potentialités. Des villes, et notamment Paris, se sont réappropriées des espaces de voiries et de stationnement par exemple pour recréer des espaces de convivialité en respectant les principes de distanciation physique, développer les mobilités alternatives, avec la création de pistes cyclables temporaires. A terme, une réflexion de fond doit s’engager sur nos infrastructures publiques et privées. Alors que les citoyens aspirent à plus de verdure et de respiration, le risque serait d’y répondre par de l’étalement urbain qui grignoterait des zones fertiles, productives et naturelles. L’enjeu est de penser en termes de chronotopie, en faisant en sorte que les aménités urbaines ne soient pas utilisées uniquement 30 ou 40% du temps mais bien davantage. En effet plus il y a d’intensité d’usages plus on est économes en m² et donc vertueux d’un point de vue environnemental. Plutôt que d’étendre les villes, il faut capitaliser sur l’existant avec des usages plus évolutifs.
Olivier Bokobza
Cette crise réinterroge aussi le rapport au « chez soi ». Nous percevions déjà les vertus des quartiers mixtes qui combinent à la fois des lieux de vie, des espaces où l’on peut télétravailler, se retrouver, bénéficier de services de proximité… qui participent à la qualité du quotidien en ville. Le confinement nous a incité à attacher encore plus d’importance à l’environnement immédiat des logements : qualité des pieds d’immeubles, commerces de proximité, aménagements, espaces verts. Ainsi, la mixité des usages (logements, bureaux, commerces), favorise le partage et crée de nouvelles formes de lien social entre habitants, commerçants, salariés, travailleurs indépendants, etc.
A quoi pourrait ressembler la ville de demain ?
Olivier Bokobza
Il n’y a pas une, mais plusieurs villes de demain. La Covid-19 est pour moi un accélérateur de la transformation de ces villes, plutôt qu’un élément qui vient complètement changer la donne. Les villes vont changer sous l’impulsion de nouvelles pratiques de travail, de consommation ou de mobilité.
Dans les années 2010, nous passions 80 % de notre temps seul à notre bureau et 20 % en réunion. Aujourd’hui ces curseurs ont évolué. Les entreprises ont la responsabilité de repenser les espaces physiques en fonction des usages qu’en font les utilisateurs.
Certaines zones urbaines vont changer de fonction. Nous voyons la limite des quartiers monofonctionnels, que ce soient des ensembles tertiaires qui ont été désertés pendant le confinement ou des ensembles résidentiels qui ont été, au contraire, sur-occupés.
Certains immeubles de bureaux obsolètes en centres-villes ne pourront pas s’adapter aux contraintes de demain et seront transformés en logements. Concevoir des villes, c’est avant tout s’appuyer sur les usages d’aujourd’hui pour les transformer au profit des usages de demain. L’un des premiers constats de cette crise, et avec toute la prudence qui s’impose, c’est la vertu de la mixité à toutes les échelles. Parce qu’elle crée du lien social et de la cohésion.

Séverine Chapus
Je suis très attachée à la notion de « territoires ressources ». Cette approche prend en compte toutes les ressources précieuses d’un territoire et suppose de travailler avec et de valoriser l’existant, le patrimoine urbain et naturel : espace, énergie, eau, biodiversité, etc. Mais ces ressources sont aussi celles des savoir-faire, des talents et des solidarités qu’une ville doit permettre de mailler, de transmettre et de délultiplier. Comment respecter ces différentes ressources dans la conception de la ville ? Comment les utiliser avec parcimonie et frugalité ? Comment les régénérer et les renouveler pour qu’elles s’épanouissent ? Dans nos métiers, nous avons une vraie responsabilité pour répondre à ces enjeux.
LIRE NOS AUTRES ACTUALITÉS

BNP Paribas Real Estate et Willow : l’IA au service d’une nouvelle génération de bâtiments
En s’associant à Willow et à son assistant intelligent Willow Copilot, BNP Paribas Real Estate franchit une nouvelle étape dans la transformation digitale de ses bâtiments.
Cette collaboration stratégique vise à renforcer la capacité des gestionnaires à exploiter pleinement les données du bâtiment, afin d’accélérer l’émergence d’immeubles plus performants, plus durables et plus attentifs aux besoins des occupants.
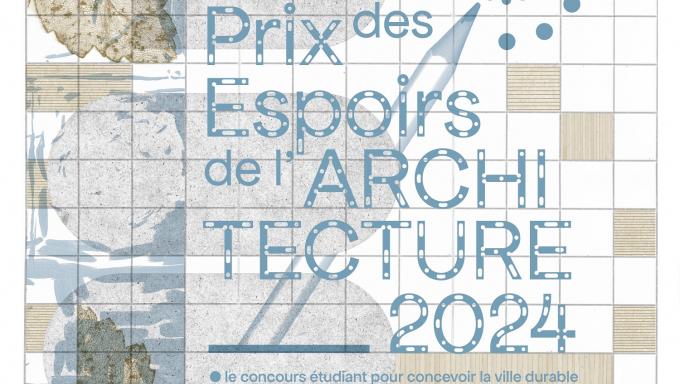
Prix des Espoirs de l’Architecture de BNP Paribas Real Estate : Qui sont les lauréats de la 17ème édition ?
Chaque année, BNP Paribas Real Estate propose le concours du Prix des Espoirs de l’Architecture aux étudiants en 4ème ou 5ème année d’architecture ou en bi-cursus architecture / ingénieur. L’objectif est de les sensibiliser aux problématiques actuelles de l’architecture, notamment en termes de développement durable.

La réversibilité immobilière est-elle la clé de la résilience urbaine ?
Les besoins des occupants évoluent de plus en plus rapidement, un rythme ardu à soutenir pour l’écosystème immobilier où les temps d’études, d’obtentions administratives et de construction sont difficilement compressibles. La solution ne serait-elle pas de bâtir autrement ? Comme nous, un immeuble peut avoir plusieurs vies, pourquoi le cantonner à un seul usage ? La réversibilité immobilière, c’est-à-dire la capacité pour un bâtiment d’anticiper et de s’adapter aux usages futurs, est-elle la clé ?

85 rue du Dessous des Berges à Paris, une reconversion immobilière vertueuse
L’immeuble de bureaux situé au 85 rue du Dessous des Berges à Paris va devenir un établissement d’enseignement supérieur. Poursuivant sa stratégie de valorisation patrimoniale, la filiale Investment Management de BNP Paribas Real Estate (REIM) transforme un des actifs phares de sa SCPI France Investipierre.